XVIIIe siècle
-
-
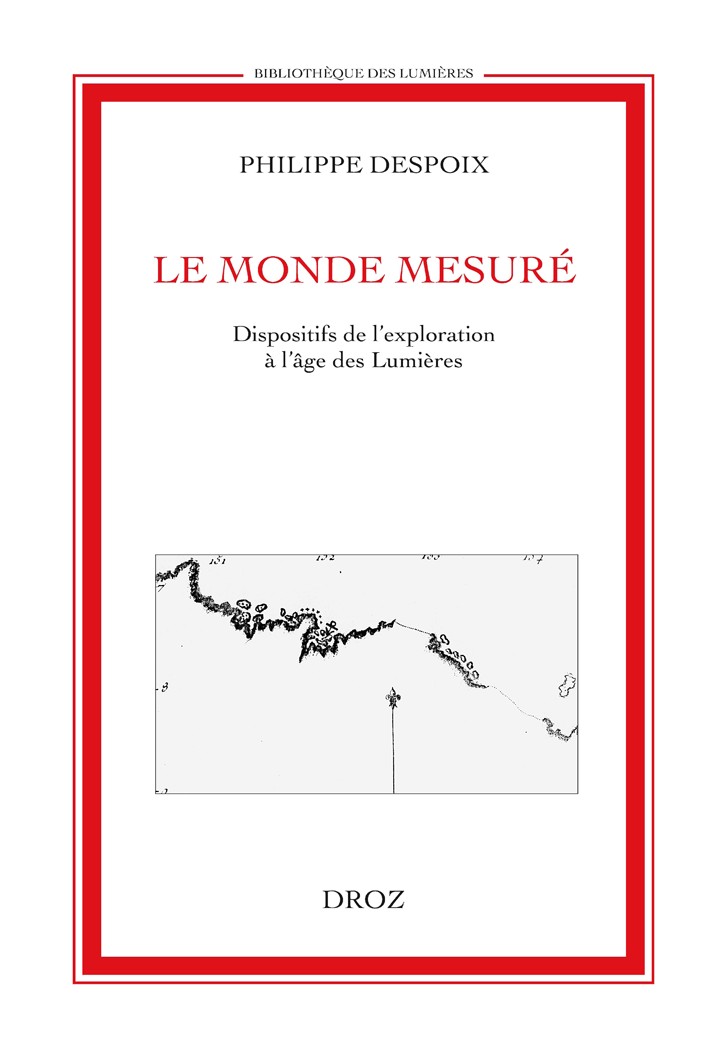
"Le Monde mesuré" rend compte des pratiques d'exploration à l'âge des Lumières, en particulier des programmes européens de circumnavigation des années 1770-80, et, partant, analyse le discours qui s'y appliqua. Pour le déchiffer, Philippe Despoix examine les a priori scientifiques de la technique d'orientation géographique de ces entreprises qui parachèvent alors la carte du monde; la répercussion que donnent à ces dernières les relations imprimées et richement illustrées circulant en Europe; les déplacements sémantiques, avec l'usage naissant de termes tels qu'«indigène», «civilisation» ou «Européen», que ces pratiques induisent; finalement il étudie les représentations esthétiques et littéraires dont elles sont l'objet. Tout un ensemble de figures nouvelles s'en dégage en effet : l'artisan horloger et ses chronomètres marins faisant concurrence au pouvoir de l'astronome royal; le voyageur auteur de sa relation qui, tel Bougainville, Cook ou Forster, détrône l'ancien compilateur; l'indigène des mers du Sud, introduit comme sujet anthropologique; mais également le public européen auquel ce discours de la découverte s'adresse désormais plus qu'aux monarques ou aux savants. L'approche comparée enseigne que les différentes représentations - scientifiques, médiatiques, fictionnelles - liées à ces pratiques exploratoires se répondent et allient les termes du savoir et du pouvoir pour défaire ceux de la souveraineté traditionnelle.
Philippe Despoix possède une double formation scientifique et philosophique. Il enseigne la littérature comparée à l'Université de Montréal et y dirige le Centre canadien d'études allemandes et européennes. Auteur de plusieurs ouvrages sur la modernité allemande, il a également coédité Crosscultural Encounters and Constructions of Knowledge in the 18th and 19th Century (2004). Ses recherches actuelles portent sur la fonction des médias dans les processus de transferts culturels.
-
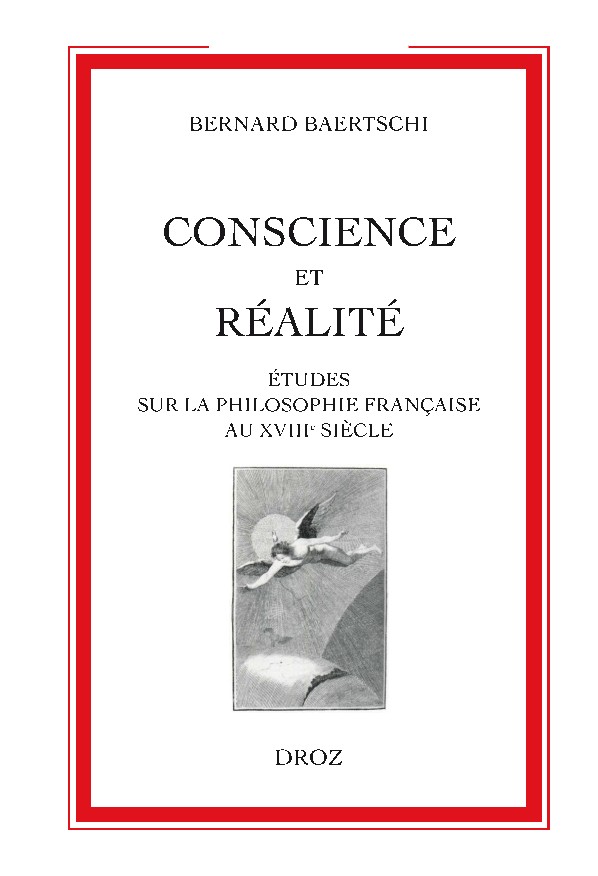
Les philosophes du XVIIIe siècle se placent sous une double bannière : celle de Descartes et celle de Locke. C'est dire que, pour eux, l'épistémologie est devenue la discipline philosophique fondamentale, qu'elle a détrôné la métaphysique identifiée avec la scolastique. D'où cette thèse, que l'on rencontre partout, que nous ne connaissons que nos idées, voire que seules nos idées existent. Comment la comprendre : signifie-t-elle, à la manière de Locke, que nous ne connaissons pas la nature des choses ou implique-t-elle, dans un style plus cartésien, un scepticisme sur l'existence du monde extérieur, voir un idéalisme ?
Que savons-nous de la réalité extérieure et comment l'appréhendons-nous ? Mais aussi : que savons-nous de nous-mêmes et comment nous connaissons-nous ? Telles sont les questions qu'examine Bernard Baertschi dans Conscience et réalité, un recueil d'études qui, le XVIIIe siècle philosophique prenant véritablement fin, en France, au début du XIXe siècle, courent de Condillac jusqu'à Maine de Biran et aux Idéologues.
-

Lorsque Buffon mourut en 1788, on rappela sa vie en deux biographies élogieuses. Disparus dix ans plus tôt, Rousseau et Voltaire étaient toujours bien vivants dans la mémoire générale. Sur Rousseau, il y eut les éloges de Bilhon et de Desmolin et, surtout, la Lettre de Madame de Staël. Voltaire fut l'objet de la critique de Gibert, de Ruault et de Linguet, en particulier. Avec Linguet, les écrivains les plus en vue étaient Condorcet et Mirabeau.
Les traductions en langue française étaient nombreuses, notamment de l'anglais et de l'allemand. La popularité du roman anglais ne montra aucun signe de recul.
La religion restait une préoccupation majeure. La publication de recueils de sermons et d'ouvrages d'instruction et d'édification répondait aux vœux des fidèles. Les protestants jouissaient alors de l'égalité civile et d'une large mesure de liberté de culte. Cette nouvelle politique, hautement controversée, fut officiellement opposée par l'Eglise.
Pour réformer le système de justice et limiter le rôle politique des parlements, le roi décida de créer une nouvelle institution, appelée la Cour plénière, dont l'administration fut confiée à Lamoignon, garde des sceaux. Ce projet suscita une violente opposition, même des émeutes, comme à Rennes et à Grenoble. Alors, pour gagner le soutien général, le roi annonça sa décision de convoquer les Etats généraux en 1789, plutôt qu'en 1792 comme il avait annoncé. Le projet d'établir la Cour plénière fut abandonné.
-

On croit bien connaître le divin marquis. Depuis deux siècles, la critique littéraire s’est bâtie sur une conviction profonde, persistante et consensuelle: l’immoralisme de Sade qui, dit-on, fait l’apologie du crime, du vice, du mal. On s’occupe de nous dire comment, on ne demande pas pourquoi. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer établit qu’il s’agit là de l’un des plus formidables contresens de l’histoire des idées. Dans quelle mesure Sade pense-t-il ce qu’il écrit? Selon une méthode rigoureuse, fondée essentiellement sur la contextualisation de l’œuvre, sont dégagées de frappantes coïncidences entre le monde sadien et la réforme pénale française du XVIIIe siècle. A travers l’environnement judiciaire d’un écrivain emprisonné se dévoile, contre toute attente, un Sade moraliste que conforte l’argumentation philosophique, juridique comme historique. En travaillant sur la totalité des textes du marquis, de la fiction à la correspondance et des ouvrages les plus fameux aux lignes habituellement négligées, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer montre pourquoi le moralisme de Sade unifie son œuvre, tandis qu’on ne pouvait jusqu’alors rendre compte de son prétendu immoralisme qu’en la divisant.
-
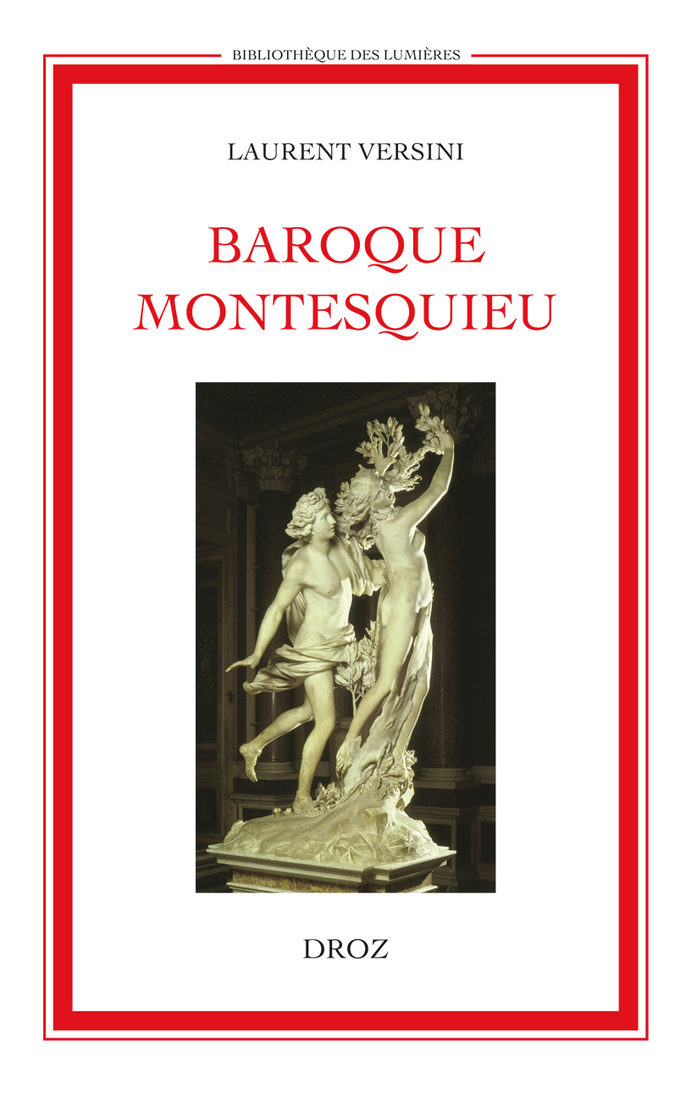
Le deux cent cinquantième anniversaire de la mort de Montesquieu invite aux bilans : la multiplication, depuis une quinzaine d'années, des études a favorisé la philologie, avec l'admirable édition des Œuvres complètes en cours à Oxford, plutôt que la synthèse. La tension d'un style bâti à coups de contrastes, de paradoxes et d'exagérations, le goût du critique d'art pénétrant pour le style rocaille qui baigne sa jeunesse comme pour la démesure de Michel-Ange et de Corneille incitent à brosser un portrait de Montesquieu autour de la notion de baroque. Cosmologie baroque où luttent le centrifuge et le centripète, éthique baroque de l'énergie guettée par son anéantissement, conception baroque de l'Histoire où la victoire vaut défaite, économie baroque où la richesse en numéraire est synonyme de ruine, foi post-tridentine comblée par le tournoiement du concave et du convexe, tout l'univers de Montesquieu obéit à la loi de l'ambivalence et préfère au principe d'identité celui d'homothétie dont il repère l'emboîtement dans la société, de l'individu à l'Etat.
Etonnant Montesquieu : on le dit depuis plus de deux siècles l'inventeur de la séparation des pouvoirs, et il répond distribution ; on le croit raisonneur, il est passionné ; on le prétend du juste milieu, il a le goût des extrêmes ; on le suppose classique, il est baroque ; c'est le Romain, et un moderne convaincu ; on le trouve démonstratif et discursif, c'est l'homme des saillies, des ellipses, des éclairs de génie. Ce Gascon que la caractérologie classe parmi les sanguins est bien frémissant, bien catégorique pour être un modéré. Un Montesquieu bouillant et caustique, voire grinçant, contre un Montesquieu un peu empesé et timoré, perd-on au change ?
-

On a longtemps pensé le XVIIIe siècle à travers l’affrontement exclusif de deux mouvements: les Philosophes exaltant la raison critique et leurs adversaires représentants des anti-Lumières. Cet ouvrage vise à étudier les marges de ce noyau dur, objet privilégié de la tradition historiographique. Le mot marges est pris dans toutes les acceptions du terme: limites, seuils, zones grises, incertaines et problématiques. Il désigne les courants de pensée les plus divers qui se situent à la frontière des mouvements philosophiques, sans basculer pour autant dans l’antiphilosophie ou les anti-Lumières.
Il montre d’abord comment les Lumières elles-mêmes pensent les limites extrêmes de la validité de leur démarche, puis examine des courants intellectuels, à l’origine divergents ou opposés, qui se rencontrent ou coexistent, dans un état de tension et d’instabilité. Dans les trente années précédant la Révolution, on a souvent recours au vocabulaire philosophique, alors qu’on adopte des positions vaguement ou ouvertement antiphilosophiques. Fruit d’un colloque international tenu à l’Université de Tours en 2001, cet ouvrage nous rappelle que l’histoire culturelle de la deuxième moitié du XVIIIe siècle est faite de contradictions et de chevauchements, parfois paradoxaux.
-
-
-